
Comment améliorer naturellement les récoltes dans son potager ?
Tous nos conseils pour enrichir votre potager
Sommaire
Pour un jardinier, y a-t-il un bonheur plus grand que celui de récolter les fruits (et les légumes) de son travail ? Les premiers radis ou les premières salades de la saison ont toujours une saveur particulière, tout comme les fraises ou les framboises que l’on picore au gré de nos envies. Au-delà du bonheur tout simple, c’est souvent la fierté qui anime le jardinier qui nourrit sa famille avec des produits sains, cultivés naturellement, nutritifs et qui permettent de (re)découvrir le goût des bons fruits et légumes. Cultiver son potager devient donc une activité enrichissante, valorisante, et parfois même un acte militant pour préserver sa santé et/ou l’environnement.
Pour autant, la réussite n’est pas toujours au rendez-vous. Et le jardinier peut aussi ressentir une grande déception face à des plantes potagères qui végètent, d’autres qui ne fructifient pas ou mal, ou encore une culture totalement envahie de ravageurs. Nous vous livrons les principaux conseils pour améliorer le sol, nourrir vos plantes et faire barrière aux ravageurs.
Bien connaître son potager pour bien le cultiver
Que vous débutiez votre potager ou que vous le cultiviez depuis longtemps, avez-vous bien pris le temps de l’observer attentivement ? Car là est la base. Pour bien cultiver son potager, il faut bien le connaître. Et surtout connaître ses différentes composantes, à savoir le sol, l’exposition, l’influence des vents, les zones moins fertiles…
Comprendre la nature de sa terre
Pour commencer, observer son sol est très important pour non seulement en comprendre la structure, mais aussi la nature. Ainsi, on ne cultive pas de la même façon dans un sol lourd et argileux que dans un sol léger et sablonneux, ou bien caillouteux. De même, un sol peut être acide, calcaire… et on ne pourra pas y planter les mêmes légumes avec la même réussite.
Plusieurs tests peuvent donc être faits pour comprendre la nature et la texture de son sol :
- Le test de la bêche (à faire au printemps ou à l’automne) consiste à prélever une bêchée de terre et de la casser en mottes. En regardant bien, vous allez découvrir des débris végétaux, des traces de présence de vers de terre à travers leurs matières fécales… De même, si la terre se casse facilement en mottes, votre sol est vivant. En revanche, si les mottes se séparent mal, les micro-organismes sont peu actifs ou absents. Une terre sombre est également un signe d’une terre riche en humus.
- Le test du boudin permet de connaître la texture d’une terre. Il suffit de prendre une poignée de terre et de l’humidifier légèrement. On peut dès lors savoir si elle est limoneuse et argileuse ou granuleuse et sableuse
- Le test du vinaigre consiste à verser quelques gouttes sur un peu de terre. Si des bulles se forment, elle est alcaline et contient du calcaire, avec un pH supérieur à 7,5. Si rien n’apparaît, elle est neutre ou acide
- Le test du bicarbonate de soude permet de voir si la terre est acide. Il faut mouiller la terre et mettre un peu de bicarbonate de soude. Si des bulles se forment, la terre est acide avec un pH inférieur à 6,5
- Le test de l’eau oxygénée permet de savoir si votre terre est riche en matières organiques. Olivier vous explique comment faire dans son article La fertilité du sol : riche ou pauvre, comment savoir ?
Pensez aussi à observer le sol après une grosse pluie pour en mesurer le drainage. Si des flaques restent, le sol n’est pas très bien drainé. Il faudra peut-être y ajouter un peu de sable.
Observer l’exposition de son potager
Il est primordial de connaître l’exposition de son potager pour optimiser les cultures et donc les récoltes. Et cette observation se fait au fil des quatre saisons d’une année.

Ainsi, un potager exposé au sud ou à l’ouest est idéal. Sinon, si votre sol bénéficie d’au moins 6 heures de soleil par jour, c’est parfait. Observez aussi les ombres portées qui en été, en période de canicule, peuvent s’avérer très utiles pour les légumes sensibles à la sécheresse. En hiver, repérez les zones soumises aux vents froids, ou gorgées d’eau.
Enrichir son sol pour obtenir de belles récoltes
Une bonne terre, riche et fertile, est le gage de beaux légumes ou fruits. Mais, au fil des années, une terre peut vite s’épuiser. Donc, il est primordial de l’enrichir et de la fertiliser pour nourrir le sol et les micro-organismes qui la composent. Il est toutefois important de retenir que l’apport de matières organiques doit être justement équilibré : il est essentiel de fertiliser le sol à la fois avec des matières carbonées et des matières azotées.

Quelques amendements pour un potager fertile
Il existe une multitude de moyens pour amender le sol :
- Le compost issu des déchets organiques d’origine végétale, transformés par des bactéries, des champignons et des insectes, est un très bon fertilisant pour le potager. Ingrid vous explique Comment faire son compost en 5 points tandis qu’Olivier évoque, dans une vidéo, le compostage de surface.
- Le fumier, riche en éléments minéraux, permet de compléter les apports de compost. Il faut toutefois veiller à choisir le bon fumier, à choisir le bon moment pour l’épandre… Je vous explique tout quant à la bonne utilisation du fumier et réponds aux 10 questions que vous vous posez sur le fumier. Quant à Virginie T., elle vous met en garde contre les erreurs à ne pas commettre avec le fumier
- La cendre de bois, riche en potassium, calcium, magnésium, silicium… peut aussi être incorporée au potager, mais à dose mesurée. Découvrez comment faire pour utiliser la cendre de bois au potager avec Virginie D.
- Les engrais verts sont semés, au printemps ou en automne, pour enrichir le sol. Ensuite, ils sont fauchés et/ou intégrés au sol pour libérer des éléments minéraux et servir d’engrais. Tout savoir sur les engrais verts avec Ingrid. Les légumineuses jouent le même rôle en apportant de l’azote. Je vous explique tout ici.
- Les purins d’ortie et de consoude ont des effets stimulants et fertilisants non pas sur le sol, mais sur les plantes. Nous vous livrons les recettes du purin d’ortie et du purin de consoude.
- Les feuilles mortes et les tontes de gazon en se décomposant vont apporter des matières organiques au sol. Ingrid vous montre comment utiliser les feuilles mortes au jardin.
- Les mycorhizes désignent une symbiose entre un champignon et une plante qui permet un échange des éléments nutritifs. Elles agissent comme des engrais. Découvrez l’univers étrange des mycorhizes et leur utilité avec Alexandra
- Les engrais naturels comme la corne broyée, le sang séché, le guano marin permettent de nourrir le sol durablement. Virginie T. vous en dit plus sur les engrais naturels au potager
- L’urine s’avère être un bon engrais azoté et phosphaté. Olivier vous détaille les différentes utilités de l’urine au potager
Découvrez d'autres Potager
Adopter les bons gestes au potager
Pour réussir son potager, il y a des gestes qui sont incontournables. Et qui se résument à quelques verbes : travailler le sol avec mesure, pailler, arroser, tailler… pour récolter les fruits de votre travail.
Travailler le sol avec mesure
Moins vous serez violent avec le sol, mieux il vous le rendra. Et mieux vous vous sentirez ! Loin de jeter la pierre aux jardiniers qui bêchent profondément leur sol, il vaut mieux travailler le sol sans le retourner pour préserver la petite faune et les bactéries qui y travaillent. Avec une grelinette (également appelée biofourche), la terre est travaillée profondément, mais sans violence. Et aussi sans efforts. Le croc peut aussi avoir son utilité dans le travail du sol, tout comme la fourche-bêche.
Olivier nous explique le fonctionnement et les avantages de la biofourche.
Quant au binage, au sarclage et au buttage, ils peuvent être évités par le paillage, le deuxième commandement pour avoir un potager fertile.
Pailler le sol, un geste aux multiples vertus
Dans la nature, un sol ne reste jamais longtemps nu. Pourquoi en serait-il autrement dans votre potager ?
Le paillage recèle donc de multiples avantages :
- Il limite l’évaporation en surface donc permet d’espacer les arrosages et de garder une certaine humidité
- Il freine la prolifération des mauvaises herbes
- Il garde une température constante et limite la surchauffe en cas de canicule
- Il évite la battance des sols et la formation d’une croûte
- Il protège les légumes des projections d’eau de pluie, sources de salissures mais aussi de propagation de maladies cryptogamiques comme le mildiou ou l’oïdium
- Il nourrit les vers de terre en se décomposant
- Il crée un écosystème favorable aux insectes auxiliaires
- Il évite le binage et le sarclage
Tout est dit ! Ne reste plus qu’à découvrir les meilleurs paillis pour le potager.

Pailler et arroser, deux gestes essentiels
Arroser à bon escient
Évidemment, inutile de préciser que l’eau est vitale pour le potager. Si elle ne tombe pas du ciel, l’arrosage devient obligatoire. Pour autant, on n’arrose pas à tort et à travers n’importe plante potagère, de la même façon ou à la même quantité. Certaines légumes sont en effet gourmands en eau, d’autres n’en ont pratiquement pas besoin.
De même, il a des périodes idéales pour arroser, mais aussi des gestes bannis.
Découvrez tous nos articles pour tout comprendre sur l’arrosage du potager :
- Arrosage du potager : nos conseils
- Réussir l’arrosage des semis : guide du débutant
- L’arrosage du jardin : comment faire ?
- Restriction d’eau et arrosage, comment gérer la crise au jardin ?
- Arroser un jardin en période de canicule
Tailler les légumes
Sans être obligatoire, la taille des légumes d’été permettrait d’obtenir des récoltes plus rapides, plus équilibrées, plus abondantes. Certains jardiniers ne taillent jamais et ont des récoltes tout aussi généreuses. Je vous laisse faire vos propres expériences et vous explique comment tailler les légumes d’été pour faire votre choix en toute connaissance de cause.
Lire aussi
10 astuces pour jardiner sans trop dépenserCultiver pour mettre toutes les chances de votre côté
Au potager, deux règles prévalent pour obtenir de beaux légumes : l’association et la rotation des cultures. Deux principes qui demandent quelques connaissances, un peu (beaucoup) de rigueur et de la patience.
L’association de cultures consiste à planter à côté (ou pas) des espèces différentes afin qu’elles se protègent mutuellement contre les prédateurs. L’exemple le plus parlant reste l’association entre la carotte et le poireau (ou l’oignon) dont les odeurs éloignent les prédateurs de chacun, à savoir la teigne du poireau et la mouche de la carotte. Pour en savoir plus sur l’association des légumes au potager, lisez l’article d’Ingrid.

Associations des poireaux et des carottes qui se protègent mutuellement
Quant à la rotation des cultures, elle se définit comme l’enchaînement d’une année à l’autre de cultures de familles différentes sur une même parcelle. Cette technique s’avère un peu complexe sur une petite surface, mais permet d’éviter bien des désagréments liés à la présence de certaines maladies ou à l’épuisement du sol.
Deux articles pour tout comprendre de la rotation des cultures :
Protéger son potager contre les maladies et les ravageurs
Une maladie ou un ravageur peut, en quelques jours, ravager une plantation de légumes, soigneusement cultivés, arrosés, paillés… et choyés. Et comme au potager, il vaut mieux prévenir que guérir, la prévention est de mise.
Contre les maladies, quelques gestes de prévention sont valables dans de nombreux cas :
- Espacer les plants pour laisser l’air circuler et éviter que les plantes potagères se transmettent les maladies
- Éviter de mouiller le feuillage pour écarter les risques de nombreuses maladies cryptogamiques. L’arrosoir est idéal comme le goutte-à-goutte ou le tuyau poreux
- Cultiver les légumes les plus sensibles à la pluie sous abri ou sous serre
- Booster les plants avec du purin d’ortie, de purin de prêle ou de purin de consoude pour qu’elles soient moins sujettes aux maladies
- Supprimer les plantes qui offrent les premiers signes de maladies.

Quelques prédateurs utiles au potager
Contre les ravageurs, vous pouvez installer dans votre jardin des solutions parfaitement naturelles comme les barrières anti-limaces, des filets anti-insectes ou encore les nématodes et les insectes auxiliaires. Sans oublier le simple fait d’attirer les prédateurs naturels que sont les oiseaux du ciel, les musaraignes, les hérissons… en multipliant les mangeoires et les nichoirs ou les abris naturels.
Pour aller plus loin :
- Abonnez-vous
- Sommaire


































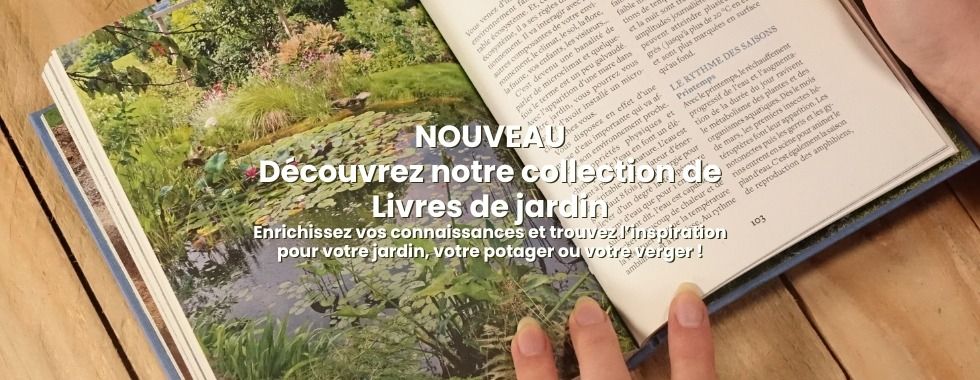
















Commentaires