
Maladies et parasites des cactus d'intérieur : comment les traiter et les prévenir ?
Comprendre les symptômes, adapter les traitements et éviter l'apparition des maladies et parasites
Sommaire
Indéniablement, les cactus sont des plantes d’intérieur, réputées leur robustesse, leur capacité à résister à la sécheresse, à survivre dans des conditions extrêmes et à se contenter de peu. Pourtant, sous nos latitudes, la culture en intérieur ne les met pas à l’abri des ennuis. Bien au contraire : confinement, humidité excessive, manque de lumière ou substrat inadapté créent un terrain favorable aux déséquilibres physiologiques, aux attaques parasitaires et au développement de maladies fongiques ou bactériennes.
Face à ces problématiques, le jardinier attentif ne doit pas seulement savoir identifier les signes d’alerte. Il doit comprendre les causes, maîtriser les gestes de prévention et adapter sa culture aux exigences spécifiques de ces plantes issues pour la plupart de milieux désertiques ou semi-arides.
Découvrez les bonnes pratiques de culture, les maladies et parasites les plus courants des cactus d’intérieur, ainsi que les moyens concrets de les prévenir pour conserver des plantes saines, vigoureuses et durables.
Pour aller plus loin : Cactus et plantes grasses d’intérieur : cultiver et entretenir
Comment bien cultiver ses cactus d'intérieur ?
Gymnocalycium, Echinopsis, Mammilaria, Astrophytum, Echeveria, Ferocactus, Parodia, Opuntia… Tous ces cactus d’intérieur demandent plus de rigueur qu’il n’y paraît. Ces plantes, souvent issues de zones arides et semi-désertiques, ont évolué pour résister à des conditions extrêmes, mais cette adaptation devient parfois un handicap en milieu confiné, où les paramètres de culture peuvent rapidement dérailler.
La première exigence concerne la lumière. La majorité des cactus sont héliophiles. Sans lumière directe pendant plusieurs heures par jour, leur métabolisme ralentit, la croissance devient étiolée, et les tissus s’affaiblissent. Une fenêtre orientée au sud ou à l’ouest est généralement recommandée, avec un filtrage léger en été si les rayons brûlent les jeunes tissus. L’insuffisance lumineuse est l’un des premiers facteurs favorisant l’apparition de maladies cryptogamiques.
Le substrat doit être strictement drainant. Un terreau spécial cactées est idéal, mais un mélange de terreau spécial rempotage, de sable et de vermiculite convient à la majorité des espèces. Une stagnation d’eau, même ponctuelle, suffit à provoquer un stress racinaire et à ouvrir la porte aux pathogènes opportunistes. Les pots en terre cuite non vernissée sont préférables aux contenants plastiques, car ils permettent une meilleure aération et évacuation de l’humidité.
L’arrosage doit être parcimonieux, en phase avec les cycles végétatifs. En période de croissance (printemps-été), un arrosage tous les 8 à 15 jours, suivant les espèces, peut être justifié, mais à condition que le substrat ait séché en profondeur. En automne, on réduit progressivement, jusqu’à stopper totalement l’apport d’eau en hiver, sauf pour quelques espèces tropicales non dormantes.

Les cactus d’intérieur demandent plus de rigueur qu’il n’y paraît
Un hivernage strict dans une pièce fraîche (5 à 10 °C), lumineuse et dénuée d’humidité est essentiel pour permettre aux cactus d’entrer dans leur phase de dormance hivernal, et, éventuellement, de préparer leur fleurissement.
Enfin, la ventilation joue un rôle trop souvent sous-estimé. Un air stagnant dans une pièce surchauffée constitue un terrain idéal pour les moisissures et les insectes ravageurs. Ouvrir régulièrement les fenêtres, même brièvement, et éviter les zones confinées (comme les vérandas mal ventilées) contribue à maintenir un équilibre sanitaire favorable.
Quelles sont les maladies les plus courantes des cactus d'intérieur ?
Malgré leur réputation de résistance, les cactus d’intérieur peuvent être sujets à plusieurs maladies, fongiques le plus souvent, parfois d’origine bactérienne, très rarement virale, mais souvent liées à des erreurs culturales.
La pourriture brune des racines
La pourriture des racines, souvent causée par des champignons du genre Pythium, Rhizoctonia ou Phytophthora, est le fléau principal. Elle se développe en sol gorgé d’eau et attaque le collet des cactus. Les racines deviennent brun clair à noires, molles, et ne remplissent plus leur rôle d’absorption, provoquant un flétrissement paradoxal des tissus aériens, car la pourriture s’étend rapidement vers le sommet du cactus. Il est difficile de traiter curativement les attaques importantes.
Que faire ?
- Déterrer le cactus et supprimer les parties atteintes à l’aide d’une lame de rasoir ou d’un cutter
- Traiter à la poudre de charbon noir
- Replanter dans un substrat neuf et parfaitement sec.
La pourriture molle
Causée par la bactérie Erwinia, cette pourriture molle se manifeste par un ramollissement rapide des tissus, avec exsudat nauséabond. La progression est généralement foudroyante. À ce stade, il est peu possible de sauver la plante entière. Le prélèvement de rejets sains, suivie d’une culture en quarantaine, est parfois la seule issue.
Le mildiou
Les tissus, fréquemment attaqués près de la base du cactus, se couvrent d’une couche blanchâtre farineuse. Les parties malades deviennent brunes et pourrissent. La plante s’effondre sur le côté. Cette maladie se développe essentiellement au printemps et en automne, lorsque le substrat est trop humide.
Que faire ?
- Faire une pulvérisation de bouillie bordelaise ou d’un fongicide naturel comme la décoction d’ail
- Réduire l’humidité autour du cactus en stoppant temporairement les arrosages et aérer la plante
Les taches brunes ou noires sur les tiges
C’est une maladie courante chez les cactus, encore une fois provoquée par une humidité et un arrosage excessifs. Ces taches sont souvent circulaires, légèrement enfoncées, de temps en temps entourées d’un halo plus clair. Les tiges se détériorent, ramollissent et s’affaissent.
Que faire ?
- Retirer le cactus de son pot
- Couper les parties atteintes avec un cutter ou une lame de rasoir bien stérilisé
- Laisser sécher la plante pendant une journée dans une pièce sèche et aérée
- Replanter le cactus dans un substrat neuf bien drainé.
Quels parasites s'attaquent souvent aux cactées d'intérieur ?
Les parasites des cactus d’intérieur sont peu nombreux, mais redoutables. Ils s’installent souvent à la faveur d’une faiblesse physiologique ou d’un microclimat trop favorable.
Les cochenilles farineuses
Ce sont les parasites les plus fréquents. Elles se logent dans les anfractuosités des tiges ou au collet, souvent invisibles au début. Les amas blancs cotonneux trahissent sa présence. Elles se nourrissent de sève, affaiblissent le cactus. Elles sont difficiles à éradiquer, car protégées par une couche cireuse.
Que faire ? Un traitement manuel à l’alcool à 70° avec un coton-tige, suivi de pulvérisations régulières de savon noir, est efficace. On peut renouveler le traitement au bout de 15 jours si nécessaire
Les araignées rouges
Les tétranyques tisserands apparaissent surtout en atmosphère sèche et chaude. Invisibles à l’œil nu, ils provoquent un aspect poussiéreux, une perte de turgescence et parfois une décoloration rouille des tissus. Les cactus laineux ou épineux masquent leur présence.
Que faire ?
- Isoler votre cactus
- Humidifier l’air ambiant et pulvériser votre cactus à l’eau non calcaire.
Les pucerons des racines
En hiver, le cactus prend un aspect maladie, jaunâtre. Les côtes se rabougrissent et les piquants sont peu solides. Au dépotage, on aperçoit des pucerons qui sucent la sève des racines.
Que faire ?
- Dépoter le cactus
- Nettoyer les racines au pinceau
- Laver le système racinaire à l’eau additionnée de savon noir
- Laisser sécher une journée et rempoter dans un substrat neuf.
Les pucerons
Des pucerons verts ou grisâtres courent dans le creux des côtes sur lesquelles ils laissent des traces de piqûres. Ils se nourrissent de la sève, ce qui fait jaunir les tissus.
Que faire ? Pulvériser une solution à base d’eau, de savon noir et d’huile
Lire aussi
Comment arroser un cactus ?Quels gestes de prévention pour éviter les maladies et attaques de parasites ?
La prévention repose avant tout sur une hygiène de culture rigoureuse, sur le respect des conditions culturales et sur l’observation attentive des plantes.
- L’assainissement du matériel est essentiel. Les pots récupérés doivent être brossés, puis désinfectés à l’eau de Javel diluée. Les outils doivent être stérilisés à l’alcool avant usage pour éviter toute contamination croisée
- Le choix du substrat ne doit jamais être laissé au hasard
- Il convient d’éviter toute surcharge en engrais azoté, qui favorise un développement trop rapide des tissus, plus sensibles aux attaques fongiques. Un engrais pour cactées, faiblement dosé et distribué une à deux fois pendant la période de croissance active, suffit
- Les arrosages ne doivent jamais être en excès
- Les pièces où sont installés les cactus doivent être aérées très régulièrement afin de changer l’air
- Si vous en avez la possibilité, en été, il est recommandé de mettre les cactées à l’extérieur, au soleil, mais à un emplacement abrité des intempéries. Les arrosages se poursuivront régulièrement
- Lors d’un achat d’un nouveau cactus, il doit être isolé du reste de la collection pendant deux à trois semaines afin de détecter la présence de maladies ou parasites
- L’inspection régulière des cactus permet d’intervenir précocement. Les parties cachées du collet, les replis entre les côtes ou les bases laineuses des tiges doivent être contrôlées à la loupe. Tout changement de couleur, flétrissement anormal ou présence suspecte doit alerter.
- Abonnez-vous
- Sommaire
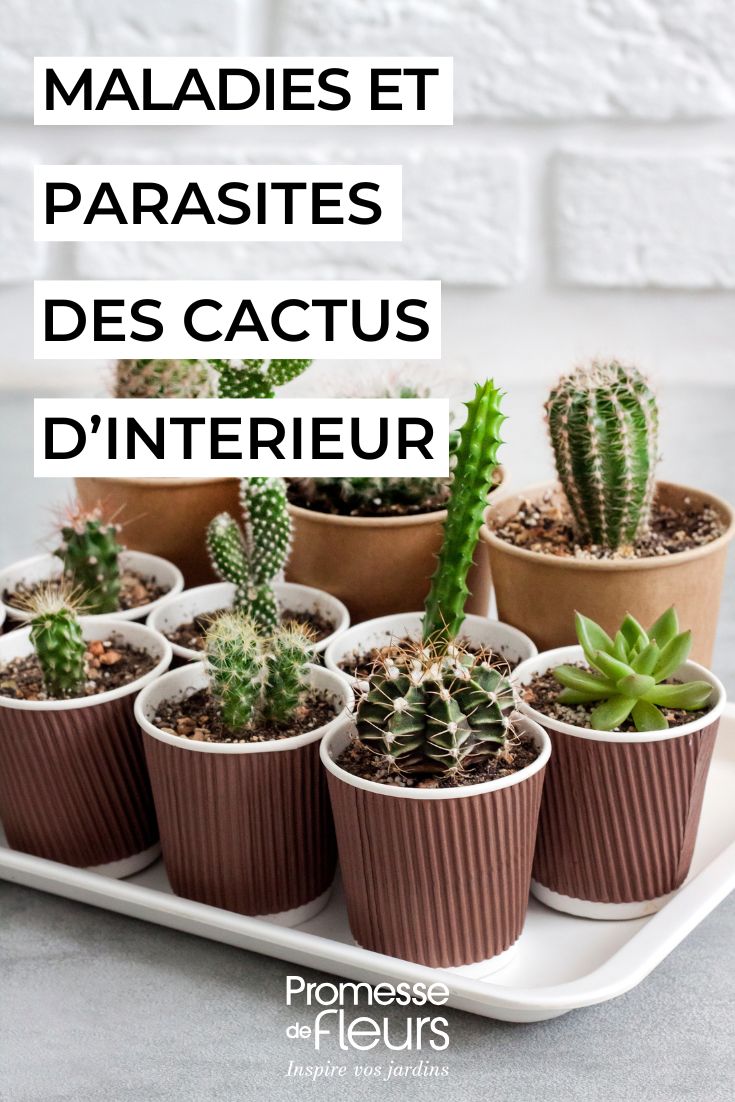



































Commentaires