
Inflorescences : tout savoir sur les différentes formes de floraison des plantes
Apprenez à reconnaître la forme des fleurs !
Sommaire
Les fleurs de nos jardins sont toutes différentes et contribuent à la grande richesse du monde floral. Au-delà de leur coloris ou de leur fragrance, leurs différences sont essentiellement le fait de formes de fleurs distinctes, qui leur donnent leur aspect unique : on décrit souvent, chez Promesse de Fleurs et dans les livres ou magazines de jardinage, la floraison d’une variété, une espèce, par le terme botanique d’inflorescence.
Ce vocabulaire spécifique à la botanique se réfère à la disposition d’un groupe de fleurs sur un axe floral, car les fleurs sont parfois simples, mais le plus souvent regroupées ensemble pour former les beautés qui nous émerveillent tant.
Sans rentrer dans un vrai cours de botanique, voici quelques rudiments sur les inflorescences les plus fréquemment rencontrées afin de mieux comprendre et apprécier la diversité des fleurs de nos jardins.
Pourquoi est-ce utile de reconnaitre les différentes inflorescences ?
Reconnaître le type d’inflorescence d’une fleur est intéressant, et ce, à plusieurs titres.
Tout d’abord, cela aide à identifier précisément les plantes, que l’on se promène dans la nature ou que l’on visite un jardin. À l’instar des feuilles, la forme et la disposition des fleurs sont en effet une des clés de détermination dans la reconnaissance des végétaux, car chaque type d’inflorescence a des caractéristiques qui lui sont propres, indiquant des différences de famille ou de genre, des adaptations évolutives et des stratégies de reproduction diverses.
En fleuristerie, les diverses inflorescences permettent de créer des bouquets avec des formes très variées et de composer avec leur esthétique.
Apprendre à les connaitre, c’est surtout pour nous, jardiniers du quotidien, apprendre à bien les utiliser et à les intégrer en les combinant dans les massifs, en jouant de leur originalité et de leurs différences !

La variété des formes de fleur est immense : une aubaine à exploiter au jardin !
Lire aussi
Les inflorescences en plumeauxLes capitules
Commençons par la plus facile des inflorescences, que l’on prend généralement à tort pour une fleur simple !
Je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément… Vous visualisez certainement parfaitement les fleurs dont on ôte les pétales un à un pour déclarer sa flamme ! Il s’agit en fait de capitules, comprenant des fleurs dites sessiles (sans pédoncule ou pétiole) regroupées de façon plus ou moins dense sur un réceptacle central en forme de disque, lui-même entouré de bractées, et de ligules que l’on prend pour des pétales et que l’on égraine peu à peu jusqu’au… pas du tout ! Elles ont une forme le plus souvent aplatie, comme chez les asters ou les marguerites, véritable piste d’atterrissage pour les butineurs. On retrouve cette forme de fleur capitulée dans une famille caractéristique, celle des astéracées (ou composées).
→ Exemples : la marguerite, le bleuet, l’érigéron, l’échinacée, le pissenlit, l’artichaut…

Bleuet, marguerite et asters
Les corymbes
Le corymbe est une autre inflorescence largement répandue chez les plantes à fleurs. Il forme un bouquet plat de fleurs dont les pédoncules (supports d’attache) sont insérés de façon étagée à diverses hauteurs sur l’axe principal, de longueurs différentes. Résultat, les fleurs se retrouvent toutes sur un même plan et peuvent former des inflorescences plates comme chez certains hortensias (Hydrangea serrata), ou des inflorescences plus bombées chez les Hydrangea aspera.
On confond parfois certains corymbes avec des ombelles : la différence étant que les fleurs des ombelles sont toutes rattachées en un point unique, rayonnant. Les corymbes se retrouvent notamment chez certaines rosacées (le pommier, poirier, prunier). Ils sont composés chez le sureau.
→ Exemples : le sureau, le physocarpus, l’aubépine, l’achillée, l’orpin d’automne, l’Ibéris…

Achillée, Hortensia serrata et sureau
Les ombelles
Cette inflorescence a tous ses pédoncules quasiment de même longueur (contrairement aux corymbes ci-dessus) insérés au même point de la tige.
Les fleurs sont ainsi disposées uniformément en rayonnement à partir d’un point unique de la tige, comme un parapluie. Les pédicelles qui portent les fleurs sont de longueur variable, ce qui fait que toutes les fleurs se retrouvent globalement sur un même plan, plus ou moins sphérique. Les ombelles peuvent être simples ou composées, ces dernières étant formées de plusieurs ombelles simples réunies en une structure plus grande, appelée ombelle composée. On retrouve ainsi des ombelles plutôt plates chez le fenouil commun et des ombelles composées (ou doubles) pour la fleur de carotte, chez qui les ombelles reproduisent un nouvel “étage” avec les ombellules.
Les ombelles sont souvent rattachées à la famille des Apiacées, également connue sous le nom d’Ombellifères. Cette famille comprend de nombreuses plantes aromatiques et médicinales, telles que la carotte, le persil, le céleri, l’angélique et l’aneth. Font aussi partie de ce type d’inflorescences de belles fleurs graphiques, puisque formant une sphère parfaite chez l’agapanthe, les alliums, les lantana ou le lierre, et attirant facilement les pollinisateurs.

Clivia, agapanthe et fenouil
Les cymes (ou cimes)
Là, ça commence à se corser un peu, car on parle en termes botaniques de cymes simples ou composées, unipares, bipares ou multipares.
Pour faire simple, disons que les cymes se caractérisent par un axe principal terminé par une fleur et qui se ramifient en développant d’autres fleurs latéralement à partir de cet axe. Les fleurs sont souvent nombreuses et petites et éclosent en décalé, d’abord la fleur terminale, puis les fleurs latérales. On la confond parfois avec l’inflorescence en racème (voir ci-dessous). À noter que ce type de floraison présente une grande diversité des formes et des tailles des cymes, qui peuvent varier d’une espèce à l’autre, car les rameaux latéraux se développent parfois uniquement d’un côté (on parle alors de cymes unipares scorpioïdes). La floraison en cymes confère aux plantes une apparence particulièrement délicate et aérienne.
→ Exemples : Trachelospermum jasminoides (faux jasmin) et Solanum jasminoides, myosotis, valériane, bourrache officinale, Ajuga reptans…

Solanum jasminoides, Ajuga reptans et myosotis
Les racèmes ou grappes
Les racèmes ou grappes sont des inflorescences simples où les fleurs sont disposées le long d’un axe central unique, sans ramifications, et rattachées par un court pédicelle. Ils sont assez faciles à identifier grâce à leur axe floral unique. La grappe peut être retombante ou dressée. Cette structure est courante chez de nombreuses plantes comme les glycines et les lupins. Les racèmes permettent une floraison ordonnée et élégante, que l’on apprécie pour sa simplicité et son charme. Les racèmes ou grappes se retrouvent chez une grande variété de plantes à fleurs, sans famille prédominante particulière.
→ Exemples : glycine, crocosmia, muguet, muscari, lupin, mimosa, jasmin blanc d’hiver…

Glycine, crocosmia et mimosa
Les thyrses
Les thyrses sont des inflorescences complexes, qui se caractérisent par une structure ramifiée où chaque axe secondaire porte lui-même des fleurs en une grappe de cymes, formant ainsi une inflorescence composée. Cette disposition prend une forme distincte de pyramide, on parle parfois de grappe thyrsoïdale, ce qui permet généralement de bien les identifier. Les thyrses composent une floraison abondante et souvent spectaculaire, attirant de nombreux pollinisateurs. Les thyrses ne sont pas spécifiques à une famille de fleurs, mais se retrouvent chez diverses espèces ornementales et sauvages.
On les adore pour leur effet particulièrement esthétique et leur floraison généreuse. Les thyrses sont aussi appréciés pour leur capacité à produire habituellement des fleurs sur une longue période, comme chez l’arbre à papillons (Buddleja davidii), offrant un intérêt visuel prolongé dans le jardin.
→ Exemples : marronnier, ornithogale, lilas, Buddleia, vigne.

Fleurs de marronnier, d’Ornithogale et de lilas
Les panicules
Les panicules sont de grandes inflorescences ramifiées, composées de grappes de fleurs individuellement pétiolées : les fleurs sont disposées de manière désordonnée et forment globalement une pyramide ou un cône. Le nombre de ramifications diminue le long de l’axe central et les fleurs sont situées sur les méristèmes terminaux, créant une structure aérée. Cette disposition est courante chez des plantes comme les hortensias asiatiques justement nommés Hydrangea paniculata. Les panicules offrent une floraison abondante, aérée et vaporeuse, apportant volume et texture aux massifs, parfaites pour les jardins naturels ou l’élégance des jardins anglais. Les noms latins de plantes portent souvent cet adjectif “paniculata”, ce qui nous aide un peu !
→ Exemples : Hortensia paniculata, Perovskia atriciplifolia, gypsophile, Phlox paniculata, Yucca gloriosa…

Hydrangea paniculata, Perovskia atriciplifolia et Yucca gloriosa
Les glomérules
Les glomérules forment un regroupement très dense et plus ou moins sphérique de nombreuses petites fleurs sessiles et sans pédoncule, ou à pédoncule raccourci. Les fleurs prennent l’aspect de petites boules et compactes, car elles sont toutes insérées au même point sur la tige, via un axe très court. Les glomérules offrent un aspect visuellement attrayant, avec leur forme globuleuse. Elles sont idéales pour créer des massifs colorés et attirent bien souvent les pollinisateurs.
→ Exemples : les monardes, les trèfles, l’Echinos ritro.

Echinops ritro, trèfle et Monarda
Les cyathes
La cyathe est typique des euphorbiacées, comme la plus connue dans nos jardins, l’Euphorbe des garrigues. On parle bien ici encore d’inflorescence, car il y a une seule fleur femelle, mais elle est entourée de plusieurs fleurs mâles groupées, le tout entouré par deux bractées.

Euphorbia characias
Les épillets et les épis
Les épillets sont un terme que l’on réserve généralement à la famille des poacées, c’est-à-dire aux graminées (même si l’on parle aussi d’épi). Le blé qui en fait partie est composé d’un épi terminal, lui-même subdivisé en plusieurs épillets. Les épillets sont aussi les inflorescences caractéristiques des joncacées (comme les luzules et les joncs) et des cypéracées (Carex, Cyperus papyrus, Cirpoides, etc.), bien que certaines puissent fleurir sous la forme de panicules ou de glomérules.
Dans notre pratique du jardin, on rencontre les épillets principalement chez toutes les graminées ornementales comme les Miscanthus et les Muhlenbergia, entre autres, et chez le Lagurus ovatus (bien qu’on l’appelle à tort chaton).

Hakonechloa macra, Miscanthus sinensis et Lagurus ovatus
Quant aux épis, c’est un mot que l’on attribue à de très nombreuses vivaces ou arbustes présentant des inflorescences caractérisées par une tige centrale sur laquelle sont disposées sur toute la longueur des fleurs sessiles, sans pédoncule. La variété des épis est grande car ils peuvent être compacts ou lâches, selon les espèces.
Les épis apportent une structure verticale et de la hauteur au jardin, indispensable dans les massifs, créant un contraste intéressant avec des plantes vaporeuses.
→ Exemples : lavande, vipérine, Callistemon, Celosia argentea, Verbena hastata, Liatris spicata, plantain…

Celosia argentea, Callistemon et Verbena hastata
Les chatons
Ce terme parle à l’enfant qui sommeille en nous et ne ressemble pas à l’idée que l’on se fait d’une fleur. C’en est pourtant bien une, poussant uniquement sur des arbres dits amentifères. Le Larousse définit le chaton comme une “inflorescence propre à divers arbres et constituée par un épi, pendant ou dressé, de minuscules fleurs unisexuées”. Cette inflorescence est toujours souple et ne comprend ni pétales, ni sépales.
Les chatons les plus communs sont ceux du saule, du noisetier, du charme ou du bouleau, mais on les voit aussi chez le Garrya elliptica, chez le peuplier et chez le chêne vert (Quercus ilex). Ce sont trois grands genres qui sont concernés : les salicacées (saule, peuplier), les fagacées (chêne, châtaignier et hêtre) et les bétulacées (charme, noisetier et aulne). Ces inflorescences ont la particularité d’apparaitre en fin d’hiver (excepté pour le châtaignier) et deviennent plus visibles au printemps quand elles libèrent leur pollen.
Ce chaton peut être une fleur mâle chez le chêne ou le noisetier, mais il s’agit d’une fleur femelle chez le saule, l’aulne et le peuplier.

Garrya eliptica, noisetier et saule
Le spadice
Pour en finir avec ce beau panel, voici une inflorescence vraiment originale et atypique. Le spadice est la fleur chez des plantes caractéristiques comme l’Arum (Zantedeschia aethiopica). Le spadice prend la forme d’un épi charnu qui rassemble une myriade de minuscules petites fleurs jaunes, blanches ou rouges selon les fleurs. Chez ces fleurs, on observe une enveloppe membraneuse plus ou moins grande et coriace selon les plantes, sorte de grand cornet à moitié ouvert en pleine floraison, qui entoure le spadice : il s’agit du spathe, de couleur blanche chez l’arum et chez le spathiphyllum, plante d’intérieur assez répandue.
Les spathes et les spadices sont caractéristiques des plantes de la famille des arécacées, dont font partie les arums, mais aussi les palmiers.
→ Exemples : l’arum des jardins, le Calla palustris, l’Anthurium, la serpentaire Dracunculus vulgaris, les palmiers.

Anthurium, Zanthedeschia aethiopica et Calla palustris
- Abonnez-vous
- Sommaire
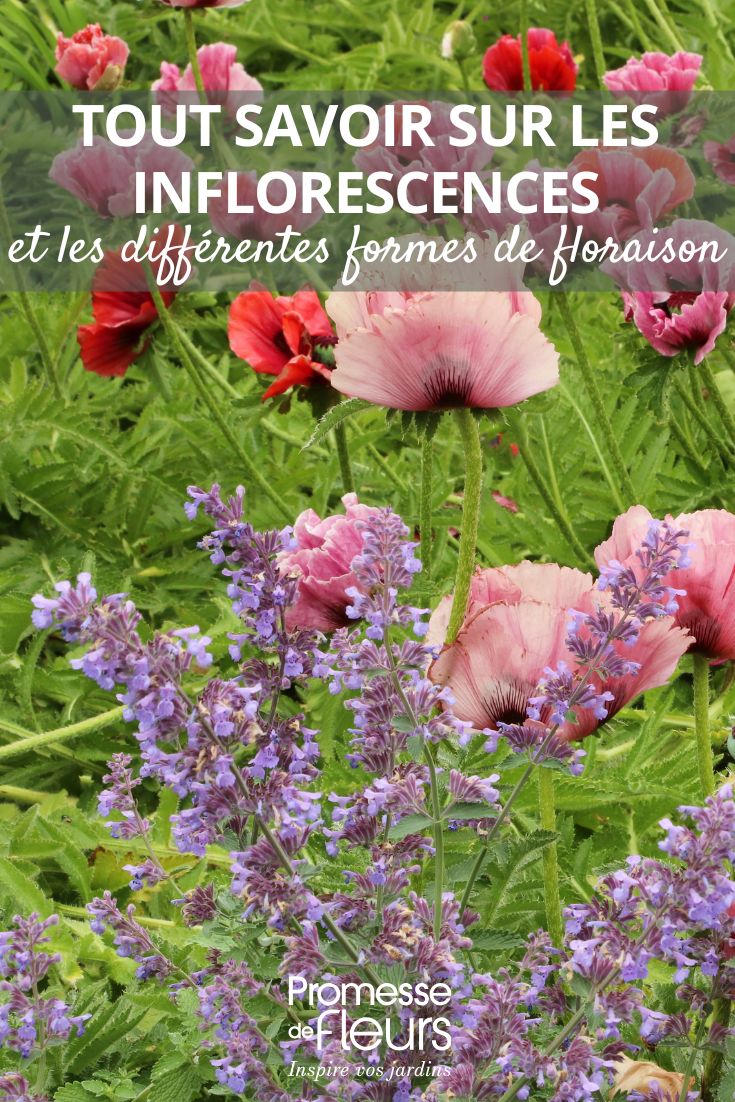

































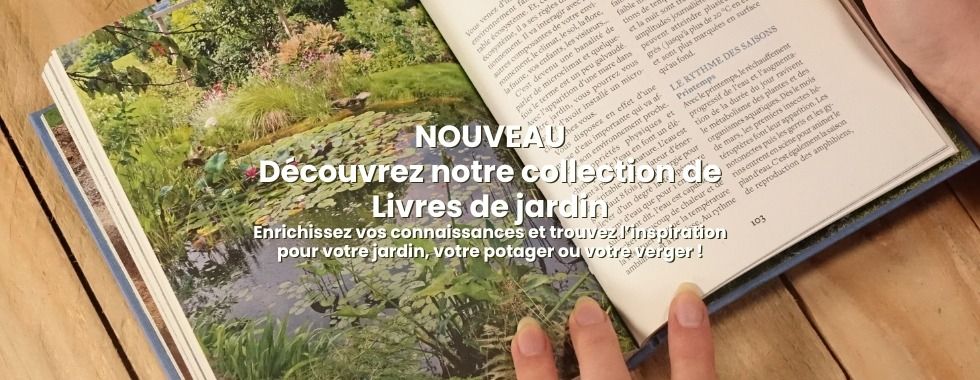
Commentaires