
Maladies et parasites de l’acanthe
Identification, prévention et solutions naturelles
Sommaire
Les acanthes sont des plantes vivaces appréciées pour leur feuillage architectural très découpé, ainsi que pour leurs hampes florales dressées de juin à septembre. Elles sont parfaites pour structurer l’espace et pour apporter du volume au jardin.
Ce sont des plantes assez faciles à cultiver, peu exigeantes, vigoureuses et rustiques jusqu’à – 15 °C. Elles se plaisent au soleil ou à la mi-ombre, dans un sol fertile, mais bien drainé. Si elles se montrent plutôt résistantes, les acanthes peuvent toutefois être sujettes à certaines maladies ou parasites.
Découvrons ensemble comment identifier les problèmes de culture les plus communs, prévenir les risques et traiter naturellement si nécessaire.
Et pour tout savoir sur la culture des acanthes, découvrez notre dossier complet : Acanthe : planter, cultiver et entretenir
L’oïdium : la maladie la plus courante chez les acanthes
Description et symptômes de la maladie
L’oïdium est une maladie cryptogamique, ce qui signifie qu’elle est causée par un champignon. Ce type de maladies fait partie des plus fréquentes au jardin, que ce soit au potager, au verger, au jardin d’ornement ou même lors de la culture en pot. C’est bien souvent un cocktail de chaleur et d’humidité qui favorise leur apparition et leur progression, c’est pour cela qu’elles apparaissent surtout du printemps à l’automne.
L’oïdium est aussi connu sous le nom de « maladie du blanc ». Ce nom fait référence à l’un de ses principaux symptômes : un feutrage blanc ou grisâtre d’aspect farineux. Chez les acanthes, il peut apparaître sur le feuillage, sur les tiges, mais aussi sur les boutons floraux. Toutes les parties aériennes peuvent être touchées.
Il s’agit d’une maladie contagieuse : les plantes aux alentours peuvent facilement être atteintes à leur tour. De plus, les spores de l’oïdium peuvent rester très longtemps en terre, parfois pendant plusieurs années, ce qui fait qu’il est difficile de se débarrasser de cette maladie.
Les dégâts causés sont tout d’abord esthétiques, mais la maladie peut provoquer au fil du temps le dessèchement des parties ariennes. Elle entraîne la chute des feuilles, la déformation des fleurs et des nouvelles pousses.
Prévention
En ce qui concerne les maladies cryptogamiques, la prévention reste le meilleur réflexe à avoir. Les traitements curatifs ne se révèlent effectivement pas toujours efficaces. Pour éviter l’apparition de l’oïdium, certains gestes gagneront à être appliqués :
- Soignez les conditions de culture, en proposant à vos acanthes un milieu adapté à leurs besoins. Plantez-les au soleil ou à l’ombre légère (surtout dans les régions les plus chaudes du sud de la France), à l’abri des vents forts. Veillez à ce que le sol soit bien drainé, afin que l’eau n’y stagne pas. Ajoutez si besoin au moment de la plantation des graviers ou des billes d’argile. Privilégiez les terres profondes et qui ne s’assèchent jamais totalement. Une plante en bonne santé est une plante plus résistante aux maladies et aux parasites. Évitez aussi de cultiver des acanthes dans une zone préalablement infectée par l’oïdium.
- Si vous cultivez plusieurs acanthes, veillez à respecter de bonnes distances de plantation pour favoriser l’aération naturelle. Pour les variétés les plus imposantes, prévoyez au moins 1 mètre entre chaque sujet. Rappelons que l’acanthe n’aime pas être déplacée : il est donc important de choisir le bon emplacement dès le départ.
- Au moment de l’arrosage, évitez au maximum de mouiller et d’éclabousser le feuillage.
- Si vous devez tailler certaines parties de la plante (feuilles abîmées, hampe florale…), utilisez toujours un outil de coupe bien aiguisé et préalablement désinfecté avec de l’alcool. Cela limite les risques de propagation de maladies entre les végétaux.
- Les acanthes ont une préférence pour les sols fertiles. Évitez toutefois d’avoir recours à des fertilisants trop riches en azote, qui peuvent fragiliser la plante et la rendre davantage sujette aux maladies.
Certains jardiniers font aussi appel aux purins de plantes en prévention. Leur efficacité n’est pas scientifiquement prouvée, mais ces recettes 100% naturelles ont tout de même la réputation de renforcer les défenses immunitaires des plantes. Cela permet d’augmenter leur résistance aux maladies. Contre l’oïdium, ce sont les purins d’ortie et de prêle qui seront privilégiés. Vous pouvez les acheter en jardinerie ou les faire vous-même en suivant nos recettes :
Traitements naturels contre l’oïdium
Pour éviter la propagation d’une maladie, l’observation régulière des plantes est indispensable. Cela permet de pouvoir agir rapidement dès le début d’un symptôme identifié. Si vous remarquez un feutrage blanc sur vos acanthes, commencez par couper immédiatement les parties infectées. Portez les déchets de taille en déchetterie (ne les laissez pas sur place et ne les mettez pas au compost, au risque que les spores survivent). Désinfectez bien vos outils de coupe après utilisation.
La bouillie bordelaise peut être utilisée en préventif comme en curatif. Il s’agit d’une poudre à base de sulfate de cuivre, qui doit être diluée dans de l’eau avant d’être pulvérisée. Elle est utilisable en agriculture biologique. Toutefois, afin qu’elle ne devienne pas contreproductive en favorisant le déséquilibre des sols, il est important de l’utiliser de manière ponctuelle et raisonnée. Il existe aussi des traitements à base de soufre pour lutter contre l’oïdium.
Enfin, les purins d’ortie et de prêle peuvent, ici encore, être utilisés, du fait des propriétés antifongiques qui leur sont prêtées. Elles devront être diluées dans de l’eau (de pluie idéalement), avant d’être vaporisées sur les parties atteintes en début ou en fin de journée.
En complément, découvrez nos articles « L’oïdium ou la maladie du blanc » et « Tout savoir sur les maladies cryptogamiques ».

L’oïdium crée un feutrage gris sur les feuilles
Les escargots et les limaces : les principaux ravageurs des acanthes
Description et symptômes
Tout jardinier connaît l’appétit dévastateur des gastéropodes. C’est le feuillage luxuriant des acanthes qui peut en pâtir. Les escargots et limaces s’attaquent en effet aux jeunes pousses dès le début du printemps. S’ils ne provoquent pas le dépérissement d’une plante adulte, ils peuvent empêcher la croissance des plus jeunes.
Prévention contre les limaces et les escargots
Il existe de nombreuses solutions préventives contre les gastéropodes. Chaque jardinier a sa technique. Vous pourrez notamment opter pour :
- les pièges à bière ;
- les barrières naturelles à base de cendre, de terre de diatomée ou de coquilles d’œufs (qui fonctionnent par temps sec et plutôt sur les petites variétés de limaces et escargots) ;
- les plantes répulsives (dont l’efficacité semble variable) ;
- la récolte manuelle des indésirables, notamment au crépuscule (chronophage, mais efficace).
Si vous souhaitez traiter vos plantes contre les limaces et les escargots, vous pouvez choisir d’épandre dès le début du printemps des traitements sous forme de granulés. À base de phosphate de fer (Ferramol), ils sont utilisables en agriculture biologique et sont réputés non toxiques pour les animaux de compagnie et pour les prédateurs des gastéropodes (oiseaux, hérissons, etc.). En agissant comme coupe-faim, ce produit pousse les limaces et les escargots à s’isoler et à arrêter de s’alimenter, ce qui provoque leur dépérissement.
Si vous vivez avec des poules ou avec des canards de type « coureur indien », vous pouvez aussi vous servir de leurs qualités de chasseurs de gastéropodes (en veillant toutefois à protéger vos pieds d’acanthe les plus jeunes, au cas où…).
Enfin, pensez à favoriser les prédateurs naturels des escargots et des limaces au jardin : oiseaux, hérissons ou encore crapauds. Pour cela, bannissez toute utilisation de produits chimiques au jardin, installez des abris et des abreuvoirs, gardez des zones sauvages, etc.

Les escargots et limaces aiment le feuillage des acanthes
Les pucerons : d’autres ravageurs occasionnels des acanthes
Description et symptômes
Ils font partie des autres ravageurs communs du jardin. Les pucerons sont ces insectes piqueurs-suceurs qui se nourrissent de la sève des plantes. Ils peuvent provoquer l’enroulement des feuilles de l’acanthe et un ralentissement de sa croissance. Et surtout, leur miellat (la substance collante qu’ils sécrètent) favorise le développement de fumagine. C’est une maladie cryptogamique qui se repère au dépôt noir ressemblant à de la suie qu’elle laisse sur les parties aériennes, ce qui va réduire le processus de photosynthèse naturel.
Traitements naturels contre les pucerons
Ici encore, nous vous conseillons d’observer régulièrement vos acanthes afin de pouvoir agir dès les premiers indésirables repérés. Si l’attaque est légère, il suffit de déloger manuellement les pucerons.
Si vous avez besoin de traiter votre plante, privilégiez un insecticide naturel. Le savon noir se révèle assez efficace. Il s’utilise dilué dans de l’eau tiède, à raison d’une à deux cuillères à soupe pour un litre d’eau. Placez ce mélange dans un vaporisateur et pulvérisez sur les parties atteintes en fin de journée.
Rappelons qu’il est nécessaire de laisser des pucerons au jardin afin de pérenniser la présence de leurs prédateurs naturels, comme les coccinelles ou les chrysopes. C’est cela qui permet d’obtenir un jardin naturellement équilibré, qui s’autorégule sans ou avec peu d’intervention humaine. Pour cela, vous pouvez cultiver des plantes comme la capucine, qui vont naturellement attirer les pucerons et les détourner des cultures à protéger.
En complément, n’hésitez pas à découvrir notre article : Puceron : identification et traitement

Les pucerons se trouvent sur le revers des feuilles
- Abonnez-vous
- Sommaire


































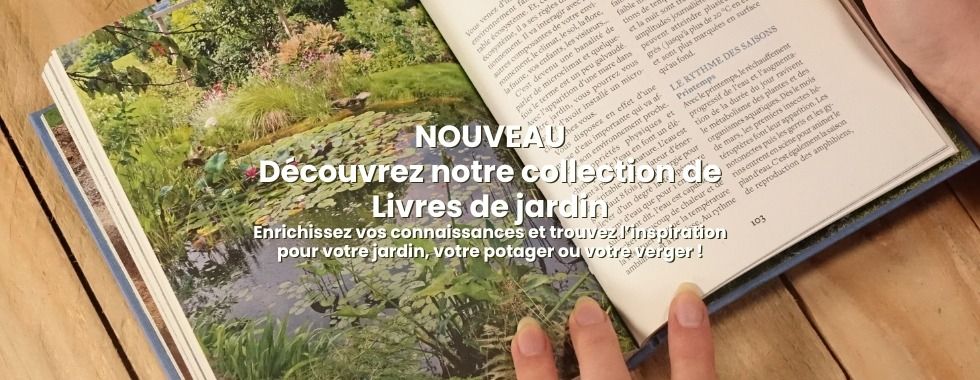
Commentaires