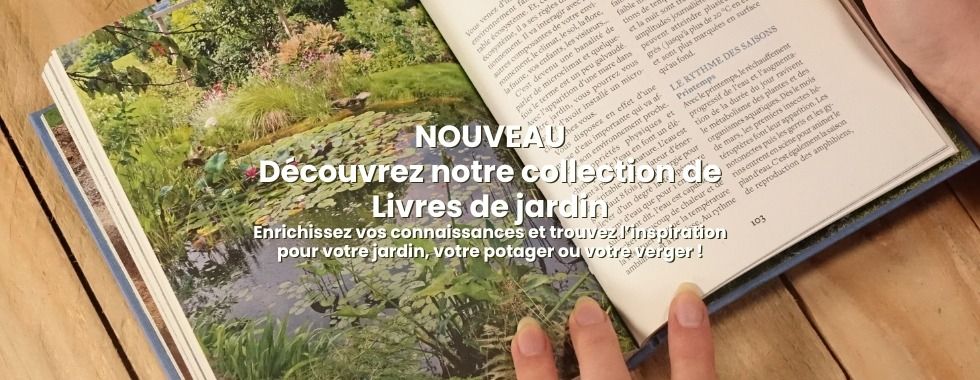Nourrir le sol naturellement
Fertiliser son potager bio : compost, fumier, engrais verts et purins
Sommaire
Nourrir son sol naturellement est la base du potager biologique. En effet, pour se développer et produire en abondance, les plantes potagères requièrent généralement une terre humifère, riche en éléments nutritifs. Ces principaux éléments, l’azote, le phosphore et le potassium, sont consommés au fil de la croissance des végétaux.
En jardin et potager naturel et biologique, la fertilisation consiste à nourrir les organismes vivants du sol (les vers de terre, les insectes décomposeurs, les bactéries et les champignons…) qui, à leur tour, nourriront la terre qui nourrira les plantes. L’objectif n’est pas simplement d’apporter des éléments nutritifs aux plantes, mais aussi d’améliorer, sur le long terme, la texture de sa terre. Voici nos conseils.
Pourquoi fertiliser naturellement son sol : les avantages
Fertiliser naturellement son potager, c’est bien plus qu’un simple geste écologique : c’est une méthode durable qui profite à la biodiversité, améliore la qualité du sol et renforce la résistance des plantes. Contrairement aux engrais chimiques, qui peuvent appauvrir la terre à long terme et perturber l’équilibre biologique du sol, les amendements organiques nourrissent l’ensemble de l’écosystème. Voici pourquoi adopter cette approche est bénéfique pour votre potager :
Un impact positif sur la biodiversité
Le sol est un véritable écosystème, abritant des millions de micro-organismes (bactéries, champignons, vers de terre, insectes décomposeurs) qui jouent un rôle essentiel dans la fertilité du potager. En utilisant du compost, du fumier ou des engrais verts, on nourrit ces organismes vivants, qui en retour :
- Décomposent la matière organique et libèrent progressivement les nutriments nécessaires aux plantes.
- Aèrent le sol en creusant des galeries (notamment les vers de terre), facilitant ainsi la pénétration de l’eau et des racines.
- Maintiennent un équilibre naturel, limitant la prolifération de parasites et de maladies du sol.
En revanche, les engrais chimiques, souvent solubles, apportent des nutriments de manière brutale et déséquilibrée. Ils favorisent une croissance rapide des plantes, mais affaiblissent à long terme l’activité biologique du sol, rendant les cultures plus dépendantes d’apports artificiels.
Une meilleure structure du sol : plus meuble et plus riche en micro-organismes
Un sol bien structuré est la clé d’un potager productif. La matière organique issue des composts, fumiers et paillis améliore la texture du sol en :
- Évitant le tassement et en favorisant un sol meuble, facile à travailler.
- Augmentant la capacité du sol à stocker et libérer les nutriments progressivement.
- Créant un environnement propice à la vie souterraine, essentielle à la santé du potager.
Les engrais chimiques, eux, n’améliorent pas la structure du sol. Pire, en cas d’usage excessif, ils peuvent le rendre compact et appauvri, limitant ainsi le développement racinaire et la circulation de l’eau et de l’air.
Une meilleure rétention d’eau et une résistance accrue aux maladies
Un sol enrichi naturellement agit comme une éponge, retenant l’eau plus efficacement tout en évitant les excès qui favorisent le développement de maladies fongiques. Grâce aux matières organiques, le sol :
- Absorbe et retient l’humidité, réduisant ainsi le besoin d’arrosage.
- Crée un environnement plus équilibré pour les plantes, leur permettant de mieux résister aux stress hydriques et climatiques.
- Améliore l’assimilation des nutriments par les plantes, renforçant leur système immunitaire contre les maladies et les attaques de ravageurs.
Lire aussi
Engrais verts : tout savoir !Apporter de la matière organique
Pour fertiliser naturellement, on apporte de la matière organique à partir :
- de compost : les déchets du jardin ainsi que les déchets de la cuisine (épluchures, restes de repas…) sont stockés et dégradés par les micro-organismes pour obtenir un amendement qui sera rendu au jardin. Le compost peut être issu du commerce.
- de fumiers d’animaux (cheval, volaille, vache…) : ils sont composés d’excréments (dominante azote), mais aussi de la litière (paille, matière carbonée), ce qui équilibre le mélange. Ces fumiers ne doivent pas être utilisés frais, mais bien décomposés, tout comme le compost. On trouve facilement du fumier déshydraté sous forme de granulés. Cette solution s’avère pratique lorsque l’on réside en ville.

Utilisez toujours du fumier bien décomposé
La fertilisation s’effectue de préférence à l’automne ou en début de printemps, à hauteur de 3 kg de compost ou fumier par m2.
Ces apports pourront être complétés par :
- l’utilisation d’engrais verts (phacélie, moutarde, vesce, sarrasin…) mais aussi de paillis d’origine organique (tontes séchées, résidus de taille broyés) qui ont l’avantage de couvrir le sol tout en le nourrissant en se décomposant,
- des produits naturels phytostimulants comme le purin d’ortie (dominante azote) ou le purin de consoude (riche en potasse et en bore). Ces purins agissent rapidement, ils stimulent croissance, floraison et fructification. Utilisés en pulvérisation, ils améliorent également la résistance foliaire.
Nota bene : en plus des engrais verts, les fabacées (pois, haricots, fèves, trèfle, lupin, vesce) captent l’azote de l’air et le restituent au sol, réduisant ainsi le besoin d’engrais. Le tagète (œillet d’Inde) et le lin, quant à eux, améliorent la structure du sol tout en éloignant certains ravageurs comme les nématodes et les insectes nuisibles, favorisant ainsi un potager plus sain et équilibré.
Les précautions indispensables lors des fertilisations
- Respecter le besoin des plantes en prenant en compte « l’appétit » du légume dont on envisage la culture à la suite de la fertilisation. À titre d’exemple, l’ail ne requiert pas d’amendement préalable, contrairement aux courges qui ne fructifient qu’en sol très riche.
- Ne pas enfouir la matière organique. Les apports doivent être réalisés en surface, il est inutile, voire néfaste, d’ensevelir profondément le compost ou le fumier, surtout s’il n’est pas mûr. Un simple griffage sur une profondeur de 5 à 10 cm est suffisant, les vers de terre et autres organismes vivants du sol se chargeront d’effectuer le mélange.
- Ne pas fertiliser à outrance. Des apports excessifs fragilisent les végétaux tout en libérant des nitrates, néfastes pour l’environnement.

Le vers de terre : un acteur essentiel à la fertilisation du sol
- Abonnez-vous
- Sommaire